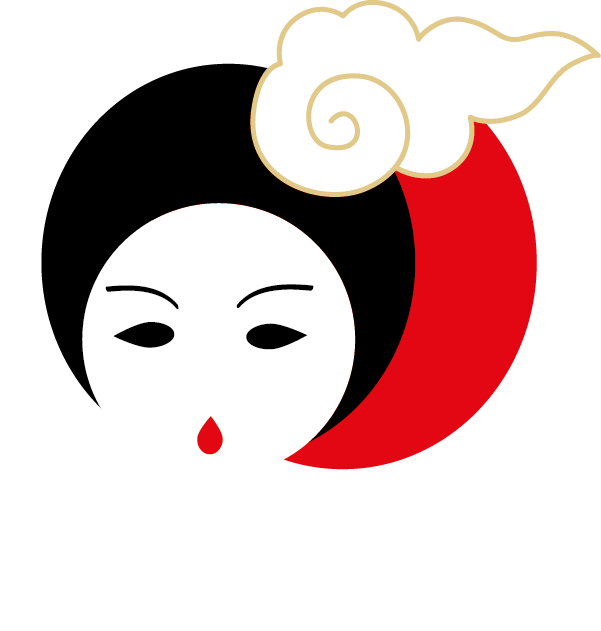Retrouvez le coffret collector Kôji Fukada en 5 films et notre critique de Suis-moi je te fuis (sortie le 11 mai 2022)
En moins d’une décennie, Kôji Fukada a prouvé qu’il était l’un des réalisateurs les plus exigeants et modernes du cinéma japonais, au même titre que Ryûsuke Hamaguchi et Katsuya Tomita. Incarnant cette relève tant attendue face à l’hégémonie des « 4 K » (Naomi Kawase, Takeshi Kitano, Hirokazu Kore-eda et Kiyoshi Kurosawa), appellation donnée à cette poignée de réalisateurs représentant systématiquement le Japon dans les festivals internationaux depuis les années 1990, ils ont su bouleverser les schémas narratifs classiques en mélangeant les genres.
C’est dans le cinéma de Kôji Fukada que cette écriture hybride s’avère la plus frappante : après avoir obtenu son diplôme à la Film School of Tokyo, il fait ses marques dans l’animation comme développeur du concept de « ganimé » – lequel combine l’image fixe (« ga ») et l’animation vidéo (« animé »). Il réalise avec cette technique inédite une adaptation de « La Grenadière » d’Honoré de Balzac, en 2006. L’œuvre prodigieuse qui en résulte, tant par la beauté de ses images que par l’ampleur de son champ musical, laissait déjà présager de sa capacité à solliciter avec puissance l’imagination du spectateur par l’usage de registres sensoriels multiples. Il ne cessera par la suite de revisiter brillamment les genres, cette fois en prise de vues réelles : la comédie sociale (Hospitalité, 2011), la chronique adolescente (Au revoir l’été, 2014), la fiction post-apocalyptique (Sayônara, 2017), le thriller psychologique (Harmonium, 2017) ou social (L’Infirmière, 2020) et plus récemment, la fable animiste (Le Soupir des vagues) ou encore la fresque amoureuse (Suis-moi je te fuis, Fuis-moi je te suis), tous deux à sortir en 2021. Il y a fort à parier que, de la part du premier réalisateur ayant jamais fait appel à un robot comme acteur (dans Sayônara), la suite de sa filmographie se révèlera tout aussi vaste que surprenante.

Plus impressionniste que naturaliste – son peintre préféré est d’ailleurs Edgar Degas – Kôji Fukada donne systématiquement à ses films une structuration chorale où il ne s’agit non pas de sursignifier les choses, mais d’esquisser subtilement une histoire, avec nuance, tout en laissant la part belle au hasard. Ses scénarios ne s’attachent ainsi jamais au cheminement d’un héros trouvant son salut après avoir surmonté une série d’obstacles, dans un déroulement formel et convenu. Bien au contraire, et c’est en cela que la notion de choralité irradie son œuvre, il cherche à restituer une vision du monde selon le croisement des regards des protagonistes, voire d’un entrelac de temporalités. Dans cette même recherche impressionniste, il bannit les gros plans pour privilégier les larges, préférant la densité d’une atmosphère et d’une palette de facettes que des illustrations trop concrètes qui cloisonneraient la complexité de ses personnages, le bouillonnement qui les habite, autant que le point de vue du spectateur. C’est, à son sens, la condition sine qua none pour faire apparaître un monde à part entière, un univers libre qui offre la possibilité de faire grandir les gens.
Il n’est pas anodin que, dans cette quête de la bifurcation intime et du remaniement identitaire, où la pulsion s’immisce forcément dans la continuité d’être, il construise ses récits au fil d’apparitions et de disparitions, afin de mieux saisir la nature des relations qui lient les personnages. Le motif de l’intrusion comme révélateur du corps intime et social est de fait le point commun de sa filmographie. Cette technique narrative lui permet de confronter ses personnages à l’arrivée d’un élément perturbateur, lequel va systématiquement remettre en cause leur apparence de bonheur, du moins d’équilibre. Si cet élément se présente généralement sous des airs anthropomorphes – un « vieil ami » débarquant au sein d’une famille comme dans Harmonium ou Hospitalité, une personnification de la Nature dans Le Soupir des vagues, une femme attisant le trouble amoureux dans Au revoir l’été, L’Infirmière ou Suis-moi je te fuis, Fuis-moi je te suis, il s’avère plus diffus dans Sayônara, où c’est la catastrophe nucléaire qui va confronter l’humanité à sa propre disparition dans une catharsis poétique. Dans tous les cas, le danger vient de l’intérieur : la science sans conscience signe autant la ruine de l’âme que la conscience sans science, où les relations se passent d’objectivité et de morale… Jusqu’à ce que toute certitude se dérobe.

L’intentionnalité qui se cache derrière n’est pourtant jamais froide et implacable. Kôji Fukada ne se prive certes pas de dénoncer les sociétés contemporaines et leur absurdité. Mais il enveloppe toujours son propos d’une matière sensible. Si ses films abordent des thèmes comme le rejet, le remord ou la vengeance, et dévoilent subtilement les secrets de familles apparemment sans histoires, ils sont gorgés d’un amour irrésolu pour le genre humain qui trouve, au cœur de ses déboires et de sa solitude, le moyen de se remettre en question. Malgré leur peur initiale de l’étranger, les personnages d’Hospitalité ne finissent-ils pas happés par une chenille festive et joyeuse ? L’androïde de Sayônara n’aide-t-il pas Tania à trouver le repos, en transcendant l’angoisse de sa mort par la beauté des poèmes qu’elle lui déclame ? L’Infirmière, à qui tout est retiré, ne se met-elle pas en résistance ? La « Nature » de Laut n’est-elle finalement pas comprise par les protagonistes du Soupir des vagues, laissant entendre que l’humanité est en mesure de surmonter la crise écologique ? L’amour n’est-il pas la seule conclusion de Suis-moi je te fuis, Fuis-moi je te suis, après les tribulations filandreuses de Tsuji et Ukiyo ? Kôji Fukada ne décline ainsi jamais le motif de l’intrusion comme justification pour mener ses personnages vers un climax violent, où la folie gronde face à une menace lourde, mais bien comme procédé pour démêler leur distanciation émotive, afin qu’émerge leur ressenti authentique.
Cette perspective rend son cinéma indéniablement rohmérien. Eric Rohmer qui, quant à lui, avait recours au motif de la discussion pour pousser ses protagonistes dans leurs retranchements, est d’ailleurs l’un des cinéastes les plus couramment cités par lui, entre autres artistes français – notons que Kôji Fukada a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en reconnaissance de sa francophilie. Si les personnages ont du mal à savoir ce qu’ils pensent et ressentent, comment le pourrions-nous ? Nous ne pouvons que supposer ce que les autres éprouvent, notre propre intimité demeurant elliptique. Il faut soit sereinement accepter l’ukiyo (notion spécifiquement japonaise exprimant le caractère éphémère d’un monde par essence « flottant »), soit surinterpréter, tergiverser et se perdre. Kôji Fukada encourage donc toujours le spectateur à remettre en question la véracité de ce qu’il a vu, entendu. Et à se rendre compte que ce qu’il croyait normal ne l’était finalement pas vraiment… La dénonciation de l’aveuglement collectif transcende ainsi son cinéma. Elle resplendit dans l’image inoubliable des quatre adolescents du Soupir des vagues qui, ayant accepté l’impartialité d’une Nature qu’ils ne peuvent maîtriser, chevauchent joyeusement la mer derrière Laut quand les habitants, par stigmatisation et méconnaissance, cherchent encore un coupable. Rêver et vivre, par-delà ses impressions : telle est la conclusion fukadienne. O. J.